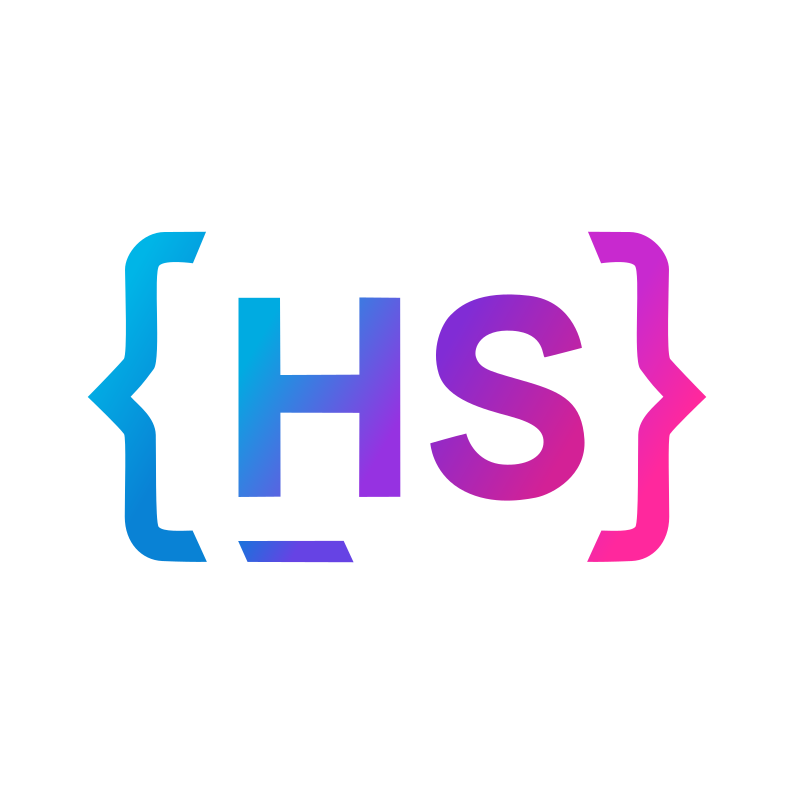Dans le cadre de notre article sur la facturation électronique en France et après avoir abordé le cadre légal – c’est-à-dire les lois, décrets et obligations qui fixent le calendrier et les responsabilités des entreprises –, il est temps d’aborder un autre pilier essentiel de la réforme : le cadre normatif.
Car si la loi définit le quoi (les obligations), ce sont les normes qui définissent le comment (les standards techniques et organisationnels à respecter). Ces normes, qu’elles soient européennes, internationales ou françaises, ont chacune leur histoire et leur rôle précis : garantir l’interopérabilité des factures, assurer leur intégrité, encadrer leur archivage et sécuriser leur transmission.
Dans cet article, nous allons passer en revue les principales normes qui structurent la facturation électronique et le e-reporting, en expliquant pour chacune d’entre elles d’où elle vient et quels sont ses principes.
La structure de la facture électronique
Avant de pouvoir être transmise, archivée ou contrôlée, une facture électronique doit d’abord être structurée de manière standardisée. C’est cette structure qui garantit qu’une facture émise par une entreprise pourra être comprise, lue et traitée automatiquement par le système de son destinataire – qu’il s’agisse d’une autre entreprise, d’une plateforme de dématérialisation ou de l’administration fiscale.
Pour répondre à cet enjeu d’interopérabilité, plusieurs normes et formats se sont imposés en Europe et en France. Certains sont purement européens (EN 16931), d’autres sont internationaux (UBL, CII), tandis que la France et l’Allemagne ont développé un format hybride, Factur-X, qui combine lisibilité humaine et structuration technique.
Dans les sections qui suivent, nous allons découvrir ces différentes normes, leur histoire et les principes qui les gouvernent.
EN 16931 : Le socle européen de la facture électronique
Publiée en 2017 par le Comité Européen de Normalisation (CEN), la norme EN 16931 constitue la pierre angulaire de la facture électronique en Europe. Elle répond à un objectif clair fixé par la Commission européenne : harmoniser les formats de factures afin de permettre aux entreprises des différents États membres de s’échanger des documents comptables sans barrière technique.
Concrètement, EN 16931 ne définit pas un fichier ou un langage informatique, mais un modèle sémantique : une liste normalisée des informations qu’une facture doit obligatoirement ou facultativement contenir (identité du vendeur, de l’acheteur, lignes de facture, montants HT et TVA, échéances, etc.). Grâce à ce vocabulaire commun, une facture française peut être comprise par un système allemand, italien ou néerlandais sans interprétation manuelle.
La norme est aussi conçue pour être interopérable avec plusieurs syntaxes techniques : XML UBL, CII, ou encore le format hybride Factur-X. En d’autres termes, elle fixe le contenu et laisse aux entreprises le choix du contenant, tant que celui-ci respecte la sémantique définie.
UBL : Le langage XML de la facture électronique
Créé au début des années 2000 par le consortium international OASIS, l’Universal Business Language (UBL) est l’un des formats les plus utilisés pour l’échange de factures électroniques, notamment dans le cadre du réseau européen Peppol.
Conçu comme un langage XML générique, UBL ne se limite pas aux factures : il couvre l’ensemble des documents commerciaux (bons de commande, avis d’expédition, catalogues…). Dans le domaine de la facturation, il fournit une structure claire qui reprend les informations définies par la norme EN 16931, ce qui garantit sa compatibilité avec les exigences européennes.
L’un de ses grands avantages est son adoption internationale : largement utilisé dans les pays nordiques et anglo-saxons, il facilite les échanges transfrontaliers. En France, il est retenu comme l’un des formats autorisés, notamment pour les entreprises qui interagissent déjà avec Peppol ou qui privilégient des échanges entièrement dématérialisés.
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2">
<cbc:ID>F2025-001</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2025-08-20</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cbc:Name>Fournisseur SA</cbc:Name>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="SIRET">12345678900011</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cbc:Name>Client SARL</cbc:Name>
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="SIRET">98765432100022</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:LegalMonetaryTotal>
<cbc:PayableAmount currencyID="EUR">1200.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
</Invoice>Langage du code : HTML, XML (xml)Exemple de facture en UBL 2.1
CII : La facture internationale de l’ONU
Le Cross Industry Invoice (CII) est un format développé par l’UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) et publié pour la première fois en 2006. Contrairement à UBL, qui est conçu par un consortium privé, CII est porté par une organisation internationale rattachée à l’ONU, ce qui lui donne une forte légitimité dans les échanges mondiaux.
Le CII repose lui aussi sur le modèle sémantique de l’EN 16931, mais il se distingue par sa grande richesse fonctionnelle. Il est capable de représenter des cas d’usage complexes : factures multi-lignes avec structures hiérarchisées, opérations transfrontalières, secteurs spécialisés (énergie, transport, finance…). Cette granularité en fait un format apprécié des grandes entreprises et des opérateurs internationaux.
Son principal inconvénient est sa complexité technique : les fichiers CII sont souvent plus lourds et plus difficiles à traiter qu’un UBL, ce qui limite son adoption par les petites structures. Néanmoins, dans le cadre de la réforme française, il fait partie des syntaxes autorisées, et il est surtout la base du format Factur-X, dont nous allons parler juste après.
<rsm:CrossIndustryInvoice
xmlns:rsm="urn:un:unece:uncefact:data:standard:CrossIndustryInvoice:100"
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:100">
<rsm:ExchangedDocument>
<ram:ID>F2025-002</ram:ID>
<ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
<ram:IssueDateTime>
<udt:DateTimeString format="102">20250820</udt:DateTimeString>
</ram:IssueDateTime>
</rsm:ExchangedDocument>
<rsm:SupplyChainTradeTransaction>
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:SellerTradeParty>
<ram:Name>Fournisseur SA</ram:Name>
<ram:ID schemeID="SIRET">12345678900011</ram:ID>
</ram:SellerTradeParty>
<ram:BuyerTradeParty>
<ram:Name>Client SARL</ram:Name>
<ram:ID schemeID="SIRET">98765432100022</ram:ID>
</ram:BuyerTradeParty>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
<ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
<ram:GrandTotalAmount currencyID="EUR">1200.00</ram:GrandTotalAmount>
</ram:ApplicableHeaderTradeSettlement>
</rsm:SupplyChainTradeTransaction>
</rsm:CrossIndustryInvoice>Langage du code : HTML, XML (xml)Exemple de facture en CII
Factur-X : L’alliance du PDF et du XML
Développé conjointement par la France et l’Allemagne et officialisé en 2017, Factur-X est un format hybride qui vise à réconcilier deux besoins souvent opposés : la lisibilité humaine et le traitement automatisé.
Concrètement, Factur-X est un PDF/A-3 (format d’archivage lisible par tous) dans lequel est embarqué un fichier XML conforme au CII, lui-même aligné sur le modèle sémantique de l’EN 16931. Résultat : une seule facture qui peut à la fois être lue visuellement par un comptable et traitée automatiquement par un logiciel.
Cette approche en fait un format très apprécié des PME et ETI qui n’ont pas encore généralisé les échanges entièrement électroniques. Il permet une transition en douceur : l’entreprise continue de manipuler un PDF classique, mais bénéficie en arrière-plan d’une structuration conforme aux exigences européennes.
En France, Factur-X est considéré comme le format de référence car il combine simplicité d’usage et conformité réglementaire. C’est aussi celui qui sera le plus fréquemment utilisé dans les premières années de la réforme, notamment pour répondre aux besoins des entreprises qui doivent émettre des factures électroniques tout en gardant un document visuellement exploitable.
Les normes d’encadrement nationales
Si les normes européennes définissent la structure et le contenu des factures électroniques, la France a jugé nécessaire d’ajouter son propre cadre de référence. L’objectif est double : adapter la réforme au contexte français et assurer la conformité des plateformes qui serviront d’intermédiaires entre les entreprises et l’administration fiscale.
Deux piliers se distinguent : la norme expérimentale XP Z12-012-014 et le référentiel de la DGFiP, qui décrit en détail les flux et le cycle de vie des factures.
XP Z12 (012 – 013 – 014) : La norme française pour les PDP et OD
Publiée par l’AFNOR en 2022, la XP Z12-012-014 est une norme expérimentale spécifiquement conçue pour la mise en œuvre de la facturation électronique en France. Contrairement aux normes européennes, qui fixent un cadre commun à tous les États membres, elle cible directement les acteurs français : les Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP) et les Opérateurs de Dématérialisation (OD).
Ses principes clés :
- Définir les exigences de conformité pour ces acteurs (sécurité, traçabilité, interopérabilité).
- Encadrer la transmission des factures et données de e-reporting vers Chorus Pro.
- Garantir un haut niveau de contrôle, d’auditabilité et d’archivage probant.
Cette norme est donc le socle technique et organisationnel français, complémentaire au cadre européen.
Le référentiel DGFiP : Les flux réglementaires
En parallèle, la DGFiP a publié un référentiel opérationnel qui décrit les fameux 14 flux réglementaires de la facturation électronique et du e-reporting. Ce document précise le cycle de vie complet d’une facture : émission, transmission, réception, rejets, statuts intermédiaires et archivage.
Ces spécifications sont indispensables pour les PDP et OD, mais aussi pour les éditeurs de logiciels de facturation et d’ERP, qui doivent aligner leurs solutions sur ces flux afin d’assurer une interopérabilité totale.
Les normes de sécurité et de confiance
Au-delà de la structure des factures et des règles françaises d’encadrement, la facturation électronique repose aussi sur un socle de confiance. En effet, une facture n’a de valeur que si l’on peut garantir son authenticité, son intégrité et la confidentialité des données qu’elle contient. C’est pourquoi la réforme s’appuie sur plusieurs normes internationales qui encadrent la sécurité de l’information et les mécanismes de signature électronique.
ISO 27001 : La sécurité de l’information
L’ISO 27001, publiée en 2005 et régulièrement mise à jour, est la norme internationale de référence en matière de management de la sécurité de l’information. Elle impose aux organisations qui la mettent en œuvre de déployer un véritable SMSI (Système de Management de la Sécurité de l’Information) : politique de sécurité, contrôle des accès, gestion des risques, chiffrement, sauvegardes, audit régulier…
Dans le cadre de la facturation électronique, elle constitue une garantie incontournable pour les plateformes PDP et OD, qui traitent quotidiennement des millions de données sensibles (informations fiscales, montants, identités des parties).
eIDAS : La confiance numérique en Europe
Le règlement eIDAS, adopté en 2014 et entré en application en 2016, encadre au niveau européen l’identification électronique et les services de confiance. Il établit les règles pour les signatures électroniques, les cachets électroniques, l’horodatage qualifié et la délivrance de certificats numériques.
Concrètement, eIDAS permet de s’assurer qu’une facture électronique n’a pas été falsifiée et qu’elle provient bien de l’émetteur déclaré. Les signatures et cachets conformes à eIDAS donnent aux factures une valeur probante équivalente à celle du papier signé.
NIS 2 : La cybersécurité des acteurs essentiels
Adoptée en 2022 et devant être transposée dans les États membres d’ici octobre 2024, la directive NIS2 (Network and Information Security 2) élargit le champ d’application des obligations de cybersécurité en Europe. Elle s’applique désormais à un grand nombre d’acteurs qualifiés « essentiels », dont les plateformes de dématérialisation.
Ses principes :
- Mettre en place des mesures de cybersécurité renforcées (gestion des incidents, tests de pénétration, sécurisation des systèmes).
- Assurer une résilience opérationnelle face aux cyberattaques.
- Déclarer rapidement aux autorités compétentes tout incident de sécurité majeur.
Pour les PDP et OD, cela signifie que la facturation électronique ne pourra pas se limiter au respect des formats : elle devra aussi s’inscrire dans une gouvernance cybersécurité robuste, sous peine de sanctions.
Les normes d’archivage probant
La dernière brique essentielle de la facturation électronique concerne l’archivage. Une facture n’a pas seulement vocation à être transmise : elle doit aussi rester lisible, intègre et exploitable pendant toute la durée légale de conservation (10 ans en France). C’est ce que l’on appelle l’archivage probant, qui repose sur des normes spécifiques.
NF Z42-013 : La référence française
Publiée pour la première fois en 1999, puis régulièrement mise à jour (dernière révision en 2020), la NF Z42-013 est la norme française qui définit les règles d’un système d’archivage électronique (SAE). Elle encadre notamment :
- La traçabilité des opérations
- Le scellement des documents (hash, empreintes)
- L’horodatage
- La gestion des accès et des droits
Elle est considérée comme la référence historique en matière d’archivage électronique probant en France et a largement inspiré les travaux internationaux.
ISO 14641 : L’équivalent international
L’ISO 14641, publiée en 2012, est directement issue de la norme NF Z42-013, adaptée au niveau international. Elle fixe les mêmes exigences pour garantir la pérennité, l’intégrité et la lisibilité des documents numériques archivés.
Pour les entreprises qui opèrent à l’international, elle offre un cadre reconnu au-delà du territoire français, assurant que leurs systèmes d’archivage répondent aux mêmes standards partout en Europe et dans le monde.
Conclusion
La facturation électronique ne se résume pas à une obligation fiscale ou à un simple changement de format. Elle repose sur un écosystème normatif complet, qui lui donne à la fois sa solidité technique et sa valeur juridique.
D’un côté, les normes de structure (EN 16931, UBL, CII, Factur-X) assurent que chaque facture peut être comprise et traitée automatiquement, quel que soit le pays ou le système utilisé. De l’autre, les référentiels français (XP Z12-012-014, spécifications DGFiP) viennent préciser les règles locales pour les PDP, OD et l’ensemble des acteurs de la réforme.
À cela s’ajoutent les normes de sécurité et de confiance (ISO 27001, eIDAS, NIS2), garantes de l’intégrité des flux et de la protection des données fiscales, et enfin les normes d’archivage probant (NF Z42-013, ISO 14641), qui permettent de conserver dans le temps des factures électroniques ayant pleine valeur légale.
En somme, la réforme française de la facturation électronique s’inscrit dans un cadre structuré, normé et sécurisé, pensé pour concilier les exigences fiscales, les besoins opérationnels des entreprises et l’harmonisation internationale.
Plus qu’une contrainte, ces normes constituent une opportunité : elles offrent aux entreprises une assurance de conformité et un socle robuste pour moderniser leurs processus comptables et financiers.
Glossaire
| Terme | Définition |
|---|---|
| OD | Opérateur de Dématérialisation – Prestataire qui accompagne les entreprises dans l’émission et la réception de factures électroniques, mais qui ne transmet pas directement à l’administration fiscale. |
| PDP | Plateforme de Dématérialisation Partenaire – Plateforme immatriculée par la DGFiP, habilitée à transmettre factures et données de e-reporting vers Chorus Pro. Elle joue un rôle central dans la réforme française. |
| PDF/A-3 | Variante normalisée du format PDF (ISO 19005-3), permettant d’intégrer des fichiers XML en pièce jointe. C’est le standard utilisé pour le format Factur-X. |
| PEPPOL | Pan-European Public Procurement Online – Réseau européen qui facilite l’échange électronique de documents commerciaux et de factures, basé notamment sur la syntaxe UBL. |
| UNECE | United Nations Economic Commission for Europe – Commission économique de l’ONU pour l’Europe, qui pilote notamment l’UN/CEFACT, à l’origine du format CII (Cross Industry Invoice). |